Amici vi parlerò dell'Isola
qui nessuno ci arriva da solo
né porto né approdo sicuro
Isola che mai sarai casa
Isola che mai sarai casa
Non giungono qui gli uomini attenti
Non giungono qui guidati dal vento
se arriva qualcuno lo portano a forza
Isola che mai sarai casa
Isola che mai sarai casa
Alcuni ci compiangono a parole
per pietà danno cibo e vestiti
ma se dico che voglio partire
nessuno che mi porti via
mai nessuno che mi porti via
E consumo consumo tutti i miei giorni
corridoio giardino volano i corvi
la mia mentre svanisce marcisce il mio cuore
nutro il mare che mi dilania
nutro il mare che mi dilania
nutro il mare che mi dilania
nutro il mare che mi dilania
qui nessuno ci arriva da solo
né porto né approdo sicuro
Isola che mai sarai casa
Isola che mai sarai casa
Non giungono qui gli uomini attenti
Non giungono qui guidati dal vento
se arriva qualcuno lo portano a forza
Isola che mai sarai casa
Isola che mai sarai casa
Alcuni ci compiangono a parole
per pietà danno cibo e vestiti
ma se dico che voglio partire
nessuno che mi porti via
mai nessuno che mi porti via
E consumo consumo tutti i miei giorni
corridoio giardino volano i corvi
la mia mentre svanisce marcisce il mio cuore
nutro il mare che mi dilania
nutro il mare che mi dilania
nutro il mare che mi dilania
nutro il mare che mi dilania
envoyé par Dq82 - 13/9/2018 - 10:01
Langue: français
Version française – L’ÎLE – Marco Valdo M.I. – 2019
Chanson italienne – L’isola – Michele Gazich – 2018

Crainte comme cri, attendue comme chant, cette œuvre peut à juste titre être décrite comme l’authentique « Spoon River » italienne. On parle de morts, c’est clair, mais les personnages impliqués ne sont pas « juste morts ». Ils sont morts deux fois : la première fois parce qu’ils étaient malades et internés dans un asile ; la deuxième fois parce que « les hôtes », les internés, d’origine juive, ont été déportés et tués. Tous les personnages racontés dans l’album vivaient, ou plutôt habitaient, sur la petite île de San Servolo, une oasis de terre pittoresque dans la lagune vénitienne. Ils vivaient dans un édifice très ancien, utilisé comme monastère pendant environ mille ans, mais en 1715, on l’a transformé en hôpital militaire et après moins de dix ans, en « hôpital psychiatrique ». Et cette destination est restée, malgré plusieurs changements, jusqu’en 1978, date à laquelle il a finalement été fermé. En ces 253 ans, dans ces murs, c’est toute une humanité qui est passée par là et qui, là, s’est brisée. On vivait là parce que quelqu’un vous y avait amené de force, parce qu’on était considéré comme « fou », inapte à la vie sociale, inapte à la vie, inadaptés et point final.
Michele Gazich a vécu sur l’île pendant environ un mois et a décidé de voir cet endroit avec les yeux d’aujourd’hui, mais en essayant de remonter le temps, en recueillant les histoires dans les dossiers individuels de milliers de personnes qui ont été enfermées dans ce lieu de tourment, en essayant de lire, dans ces journaux, la douleur et la souffrance humaines de qui est passé par cet endroit, vécu, végété, perdu sa vie. Une humanité problématique et, peut-être, pas nécessairement malade, mais seulement victime de dépressions, d’épuisement nerveux, de difficultés relationnelles. Malade ou peut-être seulement « dérangé », ou simplement ayant besoin d’un peu d’aide qui, peut-être, bien que demandée, n’est jamais arrivée. Une aide qui les aurait peut-être aidés à se libérer des angoisses de la vie quotidienne, ou du moins à les endurer, en vivant une existence « normale ». Nombreuses sont les histoires recueillies, faites de douleur et de peur, d’angoisse et d’épouvante, de silences et de hurlements nocturnes, de fantômes intérieurs et d’espérances interrompues. D’un coup d’œil, Gazich, comme les internés, pouvait observer la mer et le désir de liberté contenu dans l’horizon entre le ciel et l’eau. Avec un autre, il pouvait scruter les murs écaillés et remplis de ces « ombres » qui, dans ce lieu, ont perdu la santé mentale, l’intelligence, l’émotion, la dignité, la vie intérieure pour être, plus tard, prises et conduites au massacre, comme boucs émissaires de péchés jamais commis.
Pour écrire un album comme celui-ci, il ne pouvait suffire de lire un ou plusieurs livres, d’observer des photographies, de se remémorer la mémoire composée grâce à un article de journal ancien et périmé. Non, la réalité devait être affrontée, regardée dans les yeux, avec la peur de ne pas pouvoir y résister. Les photos des patients en prison devaient être observées et pénétrées avec soin, cadrées, intériorisées. Ces regards absents ou furieux devaient être portés au plus profond de soi pour comprendre, jusqu’au bout et autant que possible, comment ces vies ont été éteintes, lentement et avec une méthode inquiétante. En même temps que la vision des photographies, Gazich a également lu une myriade de dossiers médicaux, y compris ceux relatifs aux personnes racontées dans les chansons, dont les textes sont consignés dans le livret qui accompagne ce travail.
Il est clair que « Temuto come grido », entendu comme une chanson n’est pas un album aux couleurs douces, pastel, aux tons pleins de poésie tendre, qui est bien présente mais jamais tendre, en effet… Non, dans ces chansons (?), il y a la présence de l’humanité déchirée et crucifiée, il y a la présence de celui qui est « méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur qui sait bien souffrir, comme celui devant qui on se couvre le visage, qui a été méprisé et que nous n’avions aucune estime pour lui » (Is 53,3), il y a la présence de celui qui, encore aujourd’hui, continue à réclamer sa dignité comme personne mais ne possède plus les droits ; il y a l’image de l’homme qui se transfigure dans le tourment d’une vie sans espoir, sans lumière, sans horizon, destinée à l’oubli de l’obscurité. Il y a l’homme dans son immensité niée. Il y a l’homme défiguré et offensé, sans même un semblant de salut, même lointain, imminent, possible.…
Ce travail, on l’aura compris, n’est certainement pas un travail simple, mais intrinsèquement composé de souffrances et de désespoirs, du mal qui a pénétré chaque espace de la vie et qui, après le martyre de l’enfermement, a fait subir à ces hommes et ces femmes, coupables d’être des enfants d’Abraham, subirent la déportation dans les chambres à gaz. Un événement qui a planté, dans ces pauvres corps, dans ces esprits dévastés, un autre clou, une autre lame tranchante enfoncée pour blesser le cœur. Et, il paraît insultant de dire, peut-être dans ce voyage, dans ce dernier voyage, que l’un d’entre eux a pu penser, peut-être un instant, que la destination de ce train, était la liberté. Mais ce ne fut pas le cas.
Tout commence sur cette île, San Servolo, où le cri des internés de l’asile se perdait vers les murs ou, parfois, vers la mer, sans que personne ne puisse l’entendre.
De cette mer autour, morphologiquement peu profonde mais immense pour ceux qui étaient internés, l’île est le premier signe de la douleur vécue. Cette île, qui ne sera jamais un « chez soi », est l’endroit où les internés arrivent, non pas comme hôtes, mais comme prisonniers. Le morceau est l’image de la solitude et du sentiment de claustrophobie qu’on vit et partage dans ce lieu, où tout est limité, « Couloir, jardin » où se consument les jours pendant que les corbeaux volent autour des murs. Et chez les internés qui ne sont pas obscurcis par la folie, qui est peut-être née dans ces salles, il y a la conscience que leur douleur nourrit la mer qui, au contraire, ne remercie pas, mais avec sa perfidie, déchire leur âme. La personne qui parle (dans la chanson) est née à Venise le 28 mai 1880, dossier n° 1943/202 (année d’hospitalisation et numéro progressif d’entrée à partir du mois de janvier) et le 11 octobre 1944 sera « retirée » par ordre du commandement allemand SS et transférée dans les camps…
Chanson italienne – L’isola – Michele Gazich – 2018

San Servolo (Venise)
L'Asile : Dehors et Dedans
L'Asile : Dehors et Dedans
Crainte comme cri, attendue comme chant, cette œuvre peut à juste titre être décrite comme l’authentique « Spoon River » italienne. On parle de morts, c’est clair, mais les personnages impliqués ne sont pas « juste morts ». Ils sont morts deux fois : la première fois parce qu’ils étaient malades et internés dans un asile ; la deuxième fois parce que « les hôtes », les internés, d’origine juive, ont été déportés et tués. Tous les personnages racontés dans l’album vivaient, ou plutôt habitaient, sur la petite île de San Servolo, une oasis de terre pittoresque dans la lagune vénitienne. Ils vivaient dans un édifice très ancien, utilisé comme monastère pendant environ mille ans, mais en 1715, on l’a transformé en hôpital militaire et après moins de dix ans, en « hôpital psychiatrique ». Et cette destination est restée, malgré plusieurs changements, jusqu’en 1978, date à laquelle il a finalement été fermé. En ces 253 ans, dans ces murs, c’est toute une humanité qui est passée par là et qui, là, s’est brisée. On vivait là parce que quelqu’un vous y avait amené de force, parce qu’on était considéré comme « fou », inapte à la vie sociale, inapte à la vie, inadaptés et point final.
Michele Gazich a vécu sur l’île pendant environ un mois et a décidé de voir cet endroit avec les yeux d’aujourd’hui, mais en essayant de remonter le temps, en recueillant les histoires dans les dossiers individuels de milliers de personnes qui ont été enfermées dans ce lieu de tourment, en essayant de lire, dans ces journaux, la douleur et la souffrance humaines de qui est passé par cet endroit, vécu, végété, perdu sa vie. Une humanité problématique et, peut-être, pas nécessairement malade, mais seulement victime de dépressions, d’épuisement nerveux, de difficultés relationnelles. Malade ou peut-être seulement « dérangé », ou simplement ayant besoin d’un peu d’aide qui, peut-être, bien que demandée, n’est jamais arrivée. Une aide qui les aurait peut-être aidés à se libérer des angoisses de la vie quotidienne, ou du moins à les endurer, en vivant une existence « normale ». Nombreuses sont les histoires recueillies, faites de douleur et de peur, d’angoisse et d’épouvante, de silences et de hurlements nocturnes, de fantômes intérieurs et d’espérances interrompues. D’un coup d’œil, Gazich, comme les internés, pouvait observer la mer et le désir de liberté contenu dans l’horizon entre le ciel et l’eau. Avec un autre, il pouvait scruter les murs écaillés et remplis de ces « ombres » qui, dans ce lieu, ont perdu la santé mentale, l’intelligence, l’émotion, la dignité, la vie intérieure pour être, plus tard, prises et conduites au massacre, comme boucs émissaires de péchés jamais commis.
Pour écrire un album comme celui-ci, il ne pouvait suffire de lire un ou plusieurs livres, d’observer des photographies, de se remémorer la mémoire composée grâce à un article de journal ancien et périmé. Non, la réalité devait être affrontée, regardée dans les yeux, avec la peur de ne pas pouvoir y résister. Les photos des patients en prison devaient être observées et pénétrées avec soin, cadrées, intériorisées. Ces regards absents ou furieux devaient être portés au plus profond de soi pour comprendre, jusqu’au bout et autant que possible, comment ces vies ont été éteintes, lentement et avec une méthode inquiétante. En même temps que la vision des photographies, Gazich a également lu une myriade de dossiers médicaux, y compris ceux relatifs aux personnes racontées dans les chansons, dont les textes sont consignés dans le livret qui accompagne ce travail.
Il est clair que « Temuto come grido », entendu comme une chanson n’est pas un album aux couleurs douces, pastel, aux tons pleins de poésie tendre, qui est bien présente mais jamais tendre, en effet… Non, dans ces chansons (?), il y a la présence de l’humanité déchirée et crucifiée, il y a la présence de celui qui est « méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur qui sait bien souffrir, comme celui devant qui on se couvre le visage, qui a été méprisé et que nous n’avions aucune estime pour lui » (Is 53,3), il y a la présence de celui qui, encore aujourd’hui, continue à réclamer sa dignité comme personne mais ne possède plus les droits ; il y a l’image de l’homme qui se transfigure dans le tourment d’une vie sans espoir, sans lumière, sans horizon, destinée à l’oubli de l’obscurité. Il y a l’homme dans son immensité niée. Il y a l’homme défiguré et offensé, sans même un semblant de salut, même lointain, imminent, possible.…
Ce travail, on l’aura compris, n’est certainement pas un travail simple, mais intrinsèquement composé de souffrances et de désespoirs, du mal qui a pénétré chaque espace de la vie et qui, après le martyre de l’enfermement, a fait subir à ces hommes et ces femmes, coupables d’être des enfants d’Abraham, subirent la déportation dans les chambres à gaz. Un événement qui a planté, dans ces pauvres corps, dans ces esprits dévastés, un autre clou, une autre lame tranchante enfoncée pour blesser le cœur. Et, il paraît insultant de dire, peut-être dans ce voyage, dans ce dernier voyage, que l’un d’entre eux a pu penser, peut-être un instant, que la destination de ce train, était la liberté. Mais ce ne fut pas le cas.
Tout commence sur cette île, San Servolo, où le cri des internés de l’asile se perdait vers les murs ou, parfois, vers la mer, sans que personne ne puisse l’entendre.
De cette mer autour, morphologiquement peu profonde mais immense pour ceux qui étaient internés, l’île est le premier signe de la douleur vécue. Cette île, qui ne sera jamais un « chez soi », est l’endroit où les internés arrivent, non pas comme hôtes, mais comme prisonniers. Le morceau est l’image de la solitude et du sentiment de claustrophobie qu’on vit et partage dans ce lieu, où tout est limité, « Couloir, jardin » où se consument les jours pendant que les corbeaux volent autour des murs. Et chez les internés qui ne sont pas obscurcis par la folie, qui est peut-être née dans ces salles, il y a la conscience que leur douleur nourrit la mer qui, au contraire, ne remercie pas, mais avec sa perfidie, déchire leur âme. La personne qui parle (dans la chanson) est née à Venise le 28 mai 1880, dossier n° 1943/202 (année d’hospitalisation et numéro progressif d’entrée à partir du mois de janvier) et le 11 octobre 1944 sera « retirée » par ordre du commandement allemand SS et transférée dans les camps…
L’ÎLE
Mes amis, je vais vous parler de l’île.
Où personne n’arrive de lui-même.
Sans port ni débarcadère,
Une île où on ne sera jamais chez soi.
Une île où on ne sera jamais chez soi.
Ne parviennent pas ici les hommes conscients
Ne parviennent pas ici, les hommes guidés par le vent.
Si quelqu’un arrive, c’est de force qu’on l’amena à
L’île où il ne sera jamais chez soi.
L’île où on ne sera jamais chez soi.
Certains parfois en paroles ont compati ;
Par pitié, ils donnent des vivres et des habits,
Mais si je dis que je veux m’en aller,
Il n’y a personne pour m’emmener,
Jamais personne ne veut me sortir d’ici.
Tous mes jours se consument :
Couloir, jardin, volent les corneilles.
Mon cœur pourrit à mesure que mon moi s’efface.
Je nourris la mer qui me tourmente,
Je nourris la mer qui me tourmente,
Je nourris la mer qui me tourmente,
Je nourris la mer qui me tourmente.
Mes amis, je vais vous parler de l’île.
Où personne n’arrive de lui-même.
Sans port ni débarcadère,
Une île où on ne sera jamais chez soi.
Une île où on ne sera jamais chez soi.
Ne parviennent pas ici les hommes conscients
Ne parviennent pas ici, les hommes guidés par le vent.
Si quelqu’un arrive, c’est de force qu’on l’amena à
L’île où il ne sera jamais chez soi.
L’île où on ne sera jamais chez soi.
Certains parfois en paroles ont compati ;
Par pitié, ils donnent des vivres et des habits,
Mais si je dis que je veux m’en aller,
Il n’y a personne pour m’emmener,
Jamais personne ne veut me sortir d’ici.
Tous mes jours se consument :
Couloir, jardin, volent les corneilles.
Mon cœur pourrit à mesure que mon moi s’efface.
Je nourris la mer qui me tourmente,
Je nourris la mer qui me tourmente,
Je nourris la mer qui me tourmente,
Je nourris la mer qui me tourmente.
envoyé par Marco Valdo M.I. - 10/10/2019 - 19:06
×
![]()
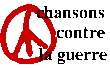








Temuto come grido atteso come canto
Dopo Non al denaro non all’amore né al cielo, che la genialità di Fabrizio De André portò all’attenzione del pubblico italiano, questo lavoro si può definire, a buon titolo, l’autentica ‘Spoon River’ italiana. Si parla di morti, questo è chiaro, ma i personaggi coinvolti non sono “morti e basta”. Loro sono morti due volte: la prima volta perché malati ed internati in un manicomio; la seconda volta perché ‘gli ospiti’, i reclusi, di origine ebraica, furono deportati ed uccisi. Tutti i personaggi raccontati nell’album hanno vissuto, o meglio, abitato, nell’isoletta di San Servolo, pittoresca oasi di terra della laguna veneta. Abitavano in una struttura molto antica, adibita a monastero per circa mille anni, ma che nel 1715 venne adibita ad ospedale militare e dopo neanche dieci anni venne trasformata in ‘manicomio’. E con questa destinazione è rimasta, nonostante vari passaggi, fino al 1978 quando fu chiuso definitivamente. In questi 253 anni, in quelle mura, è l’umanità intera che vi è passata e che lì, si è frantumata. Vi abitavano perché qualcuno ve li aveva portati, con la forza, perché ritenuti “matti”, inadatti alla vita sociale, inadatti alla vita, inadatti e basta.
Michele Gazich ha vissuto sull’isola per circa un mese ed ha deciso di leggere quel luogo con gli occhi di oggi ma cercando di andare indietro nel tempo, raccogliendo le storie presenti nelle schede personali delle migliaia di persone che in quel luogo di tormento vennero recluse; cercando di leggere, in quelle carte, l’umanità dolente e sofferente che in quel luogo è transitata, ha vissuto, ha vegetato, ci ha perso la vita. Un’umanità problematica e, magari, non necessariamente malata ma solamente vittima di depressioni, di esaurimenti nervosi, di difficoltà relazionali. Malati o forse solamente ‘disturbati’, oppure semplicemente necessitanti di un piccolo aiuto che, magari, pur richiesto non gli è mai arrivato. Un aiuto che forse li avrebbe aiutati a liberarsi dalle angosce del quotidiano, o almeno a sopportarle, vivendo un’esistenza ‘normale’ (qui sotto una foto d'archivio di qualche anno fa di San Servolo).
Tante le storie raccolte, fatte di dolore e di paure, di angosce e di spaventi, di silenzi e di urla notturne, di fantasmi interiori e di speranze interrotte. Con uno sguardo Gazich, come i reclusi, poteva osservare il mare e l’anelito di libertà racchiuso nell’orizzonte tra il cielo e l’acqua. Con un altro poteva scrutare le mura scrostate e piene di quelle “ombre” che in quel luogo persero la sanità mentale, l’intelletto, l’emozione, la dignità, la vita interiore per essere, in seguito, prelevate e condotte al macello, come capri espiatori di peccati mai commessi.
Per scrivere un album come questo, non poteva essere sufficiente la lettura di uno o più libri, l’osservazione di fotografie, la memoria composta grazie a qualche lontano e consumato articolo di giornale. No, la realtà andava affrontata, guardata negli occhi, con la paura di non poterle resistere. Le foto dei pazienti lì reclusi dovevano essere osservate e penetrate con attenzione, squadrate, interiorizzate. Quegli sguardi assenti, oppure furibondi, dovevano essere portati all’interno del sé più interiore per comprendere, fino in fondo e semmai fosse possibile, come quelle vita sono state spente, lentamente, e con inquietante metodo. Insieme alla visione delle fotografie, Gazich ha letto anche miriadi di cartelle cliniche, tra cui quelle relative alle persone raccontate nelle canzoni, i cui testi sono riportati nel bel libretto che accompagna quest’opera (un plauso al bel lavoro curato da Alice Falchetti).
È evidente che Temuto come grido, atteso come canto non è un album dalle tinte morbide, dai colori pastello, dai toni colmi di tenera poesia, che comunque è presente ma non è mai tenera, anzi… No, in queste canzoni (?) c’è la presenza dell’umanità straziata e crocifissa, c’è la presenza di chi è ”disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima” (Isaia 53,3), c’è la presenza di chi, ancora oggi, prosegue nel reclamare la sua dignità di persona ma non ne possiede più i diritti; c’è l’immagine dell’uomo che viene trasfigurato nello strazio di una vita senza più speranza, senza luce, priva di orizzonti, destinata all’oblio dell’oscurità. C’è l’uomo nella sua immensità negata. C’è l’uomo deturpato ed offeso, senza più neppure la parvenza di una salvezza, seppure lontana, imminente, possibile…
Questo lavoro, lo si sarà compreso, non è certamente di semplice fattura ma intrinsecamente composto da sofferenze e disperazioni, dal male che ha pervaso ogni spazio della vita e che, dopo la sofferente reclusione, ha fatto subire a quegli uomini ed a quelle donne, colpevoli di essere figli di Abramo, la deportazione verso le camere a gas. Un evento che ha piantato, in quei poveri corpi, in quelle devastate menti, un altro chiodo, un'altra lama tagliente penetrata ad offendere il cuore. E, pare una bestemmia dirlo, forse in quel viaggio, in quell’ultimo viaggio, qualcuno di loro avrà anche pensato, forse per un istante, che l’approdo di quel treno, era la libertà. Ma così non fu.
L’album è strutturato in tre parti: un prologo, un gruppo di canzoni dedicato ad alcune persone recluse (i cui nomi sono di fantasia, ma sempre ispirati dalla storia personale di ogni paziente) e un saluto, per un totale di undici brani a comporre un mosaico di prodigiosa suggestione. Ma se ogni persona ha un senso ed un valore, ancor di più lo possiede chi ha vissuto in situazioni difficili, di tormento, di disintegrazione della propria umanità. Tutto comincia da quell’isola, San Servolo, dove il grido dei reclusi nel manicomio si perdeva verso le mura o, talvolta, verso il mare, senza che nessuno potesse ascoltarlo.
isolachenoncera
Da questo mare intorno, poco profondo morfologicamente ma immenso per coloro che erano reclusi, L’isola è il primo segnale del dolore vissuto. Quest’isola, che non sarà mai casa, è il luogo in cui arrivano i reclusi, non ospiti ma prigionieri. Il brano è l’immagine della solitudine e del senso di claustrofobia che si vive e si condivide in quel luogo, dove tutto è limitato, "Corridoio, giardino" laddove si consumano i giorni mentre i corvi volano intorno alle mura. E nei reclusi non ottenebrati dalla follia, quella magari intervenuta proprio in quelle stanze, vi è la consapevolezza che il loro dolore alimenta il mare che, al contrario, non ringrazia ma con la sua perfidia, dilania loro l’anima. La persona che parla è nata a Venezia il 28 Maggio 1880, cartella n° 1943/202 (anno del ricovero e numero progressivo di ingresso a partire dal mese di Gennaio) e l’11 Ottobre del 1944 verrà “ritirato” per ordine del Comando SS Germanico e trasferito nei campi… Il suono del violino riporta alla mente le suggestioni sonore del film Schindler’s List e subito cattura l’anima, mentre l’incedere ritmico della chitarra acustica ricorda il salmodiare delle processioni. Le note del violino tagliano l’aria, si manifestano come un grido sommesso e rendono evidente la separazione “tra un prima ed un dopo” della vita. La voce di Gazich è omerica e ricorda le suggestive visioni create dalle parole di Giuseppe Ungaretti nel racconto della mitica “Odissea” televisiva degli anni ’60.