In giardino il ciliegio è fiorito
agli scoppi del nuovo sole,
il quartiere si è presto riempito
di neve di pioppi e di parole.
All'una in punto si sente il suono
acciottolante che fanno i piatti,
le TV sono un rombo di tuono
per l'indifferenza scostante dei gatti
Come vedi tutto è normale
in questa inutile sarabanda
ma nell'intreccio di vita uguale
soffia il libeccio di una domanda
punge il rovaio di un dubbio eterno
un formicaio di cose andate,
di chi aspetta sempre l'inverno
per desiderare una nuova estate.
Son tornate a sbocciare le strade,
ideali ricami del mondo,
ci girano tronfie la figlia e la madre
nel viso uguali e nel culo tondo,
in testa identiche, senza storia,
sfidando tutto, senza confini,
frantumano un attimo quella boria
grida di rondini e ragazzini
Come vedi tutto è consueto
in questo ingorgo di vita e morte,
ma mi rattrista, io sono lieto
di questa pista di voglia e sorte
di questa rete troppo smagliata,
di queste mete lì da sognare,
di questa sete mai appagata,
di chi starnazza e non vuol volare.
Appassiscono piano le rose,
spuntano a grappi i frutti del melo,
le nuvole in alto van silenziose
negli strappi cobalto del cielo.
Io sdraiato sull'erba verde
fantastico piano sul mio passato
ma l'età all'improvviso disperde
quel che credevo e non sono stato
Come senti tutto va liscio
in questo mondo senza patemi,
in questa vista presa di striscio,
di svolgimento corretto ai temi,
dei miei entusiasmi durati poco,
dei tanti chiasmi filosofanti,
di storie tragiche nate per gioco
troppo vicine o troppo distanti.
Ma il tempo, il tempo chi me lo rende ?
Chi mi dà indietro quelle stagioni
di vetro e sabbia, chi mi riprende
la rabbia e il gesto, donne e canzoni,
gli amici persi, i libri mangiati,
la gioia piana degli appetiti,
l'arsura sana degli assetati,
la fede cieca in poveri miti ?
Come vedi tutto è usuale,
solo che il tempo chiude la borsa
e c'è il sospetto che sia triviale
l'affanno e l'ansimo dopo una corsa,
l'ansia volgare del giorno dopo,
la fine triste della partita,
il lento scorrere senza uno scopo
di questa cosa che chiami vita.
agli scoppi del nuovo sole,
il quartiere si è presto riempito
di neve di pioppi e di parole.
All'una in punto si sente il suono
acciottolante che fanno i piatti,
le TV sono un rombo di tuono
per l'indifferenza scostante dei gatti
Come vedi tutto è normale
in questa inutile sarabanda
ma nell'intreccio di vita uguale
soffia il libeccio di una domanda
punge il rovaio di un dubbio eterno
un formicaio di cose andate,
di chi aspetta sempre l'inverno
per desiderare una nuova estate.
Son tornate a sbocciare le strade,
ideali ricami del mondo,
ci girano tronfie la figlia e la madre
nel viso uguali e nel culo tondo,
in testa identiche, senza storia,
sfidando tutto, senza confini,
frantumano un attimo quella boria
grida di rondini e ragazzini
Come vedi tutto è consueto
in questo ingorgo di vita e morte,
ma mi rattrista, io sono lieto
di questa pista di voglia e sorte
di questa rete troppo smagliata,
di queste mete lì da sognare,
di questa sete mai appagata,
di chi starnazza e non vuol volare.
Appassiscono piano le rose,
spuntano a grappi i frutti del melo,
le nuvole in alto van silenziose
negli strappi cobalto del cielo.
Io sdraiato sull'erba verde
fantastico piano sul mio passato
ma l'età all'improvviso disperde
quel che credevo e non sono stato
Come senti tutto va liscio
in questo mondo senza patemi,
in questa vista presa di striscio,
di svolgimento corretto ai temi,
dei miei entusiasmi durati poco,
dei tanti chiasmi filosofanti,
di storie tragiche nate per gioco
troppo vicine o troppo distanti.
Ma il tempo, il tempo chi me lo rende ?
Chi mi dà indietro quelle stagioni
di vetro e sabbia, chi mi riprende
la rabbia e il gesto, donne e canzoni,
gli amici persi, i libri mangiati,
la gioia piana degli appetiti,
l'arsura sana degli assetati,
la fede cieca in poveri miti ?
Come vedi tutto è usuale,
solo che il tempo chiude la borsa
e c'è il sospetto che sia triviale
l'affanno e l'ansimo dopo una corsa,
l'ansia volgare del giorno dopo,
la fine triste della partita,
il lento scorrere senza uno scopo
di questa cosa che chiami vita.
envoyé par Riccardo Venturi - 28/6/2009 - 00:15
Langue: français
Version française de Riccardo Venturi

Tirée du forum Usenet it.cultura.linguistica, francese, 16 octobre 2003.

Francesco Guccini.
Tirée du forum Usenet it.cultura.linguistica, francese, 16 octobre 2003.
LETTRE
Dans le parc, un cerisier a fleuri
à l'éclat du nouveau soleil,
tout le quartier vite s'est rempli
de neige de peupliers, et de paroles,
à une heure pile on entend les verres
et les assiettes qui s'entreclaquent,
les télés sont comme un tonnerre
pour les chats à l'indifférence distante.
Comme tu vois, tout est normal
dans cette inutile confusion
mais sur la vie de tous les jours
souffle le mistral d'une question,
piquent les ronces d'un doute infini,
la fourmilière des choses passées
de ceux qui attendent toujours l'hiver
pour désirer encore l'été.
Et encore fleurissent les rues,
ces dentelles idéales du monde
et s'y promènent la fille et la mère
à la même gueule, aux mêmes fesses rondes,
aux mêmes idées et sans histoire;
mais, tout défiant et sans limites,
des cris d'enfants et d'hirondelles
brisent leur orgueil, leur arrogance.
Tu vois, c'est comme d'habitude
dans ce bouchon de vie, de mort;
ça me rend triste, mais je m' réjouis
de ce rail d'envie et de chance,
de ce filet aux mailles cassées,
de ces buts dont on rêve encore,
de cette soif jamais étanchée
d'un qui s'ébroue et ne veut voler.
Et les roses fânent lentement,
poussent en grappes les fruits du pommier
là-haut, des nuages passent en silence
par les trous d'un ciel bleu-cobalt;
et moi, j' m'allonge sur l'herbe verte
en rêvant doucement de mon passé,
mais mon âge entraîne le perte
de ce qu' je croyais et je n'ai pas été.
Comme tu vois, tout marche bien
dans ce monde sans tourments,
dans cette vue à vol d'oiseau,
dans la rédaction bien correcte
de mes passions de courte durée,
de mes fatras de philosophie,
d'histoires tragiques commencées par jeu
trop proches ou parfois trop distantes.
Le temps, qui me rendra mon temps?
Qui me rendra ces saisons à moi
de verre et sable, qui va m' reprocher
ma rage, un geste, femmes et chansons?
Mes amis perdus, mes livres dévorés,
la joie ordinaire de mon appétit
la soif très saine des assoiffés,
la foi aveugle en de pauvres mythes?
Comme tu vois, rien n'a changé
sauf que le temps a fermé sa bourse
et je soupçonne qu' c'est banal
trop haleter après la course,
l'angoisse vulgaire du lendemain,
la triste fin de cette partie,
l'écoulement lent et sans un but
de ce truc qu'on appelle vie.
Dans le parc, un cerisier a fleuri
à l'éclat du nouveau soleil,
tout le quartier vite s'est rempli
de neige de peupliers, et de paroles,
à une heure pile on entend les verres
et les assiettes qui s'entreclaquent,
les télés sont comme un tonnerre
pour les chats à l'indifférence distante.
Comme tu vois, tout est normal
dans cette inutile confusion
mais sur la vie de tous les jours
souffle le mistral d'une question,
piquent les ronces d'un doute infini,
la fourmilière des choses passées
de ceux qui attendent toujours l'hiver
pour désirer encore l'été.
Et encore fleurissent les rues,
ces dentelles idéales du monde
et s'y promènent la fille et la mère
à la même gueule, aux mêmes fesses rondes,
aux mêmes idées et sans histoire;
mais, tout défiant et sans limites,
des cris d'enfants et d'hirondelles
brisent leur orgueil, leur arrogance.
Tu vois, c'est comme d'habitude
dans ce bouchon de vie, de mort;
ça me rend triste, mais je m' réjouis
de ce rail d'envie et de chance,
de ce filet aux mailles cassées,
de ces buts dont on rêve encore,
de cette soif jamais étanchée
d'un qui s'ébroue et ne veut voler.
Et les roses fânent lentement,
poussent en grappes les fruits du pommier
là-haut, des nuages passent en silence
par les trous d'un ciel bleu-cobalt;
et moi, j' m'allonge sur l'herbe verte
en rêvant doucement de mon passé,
mais mon âge entraîne le perte
de ce qu' je croyais et je n'ai pas été.
Comme tu vois, tout marche bien
dans ce monde sans tourments,
dans cette vue à vol d'oiseau,
dans la rédaction bien correcte
de mes passions de courte durée,
de mes fatras de philosophie,
d'histoires tragiques commencées par jeu
trop proches ou parfois trop distantes.
Le temps, qui me rendra mon temps?
Qui me rendra ces saisons à moi
de verre et sable, qui va m' reprocher
ma rage, un geste, femmes et chansons?
Mes amis perdus, mes livres dévorés,
la joie ordinaire de mon appétit
la soif très saine des assoiffés,
la foi aveugle en de pauvres mythes?
Comme tu vois, rien n'a changé
sauf que le temps a fermé sa bourse
et je soupçonne qu' c'est banal
trop haleter après la course,
l'angoisse vulgaire du lendemain,
la triste fin de cette partie,
l'écoulement lent et sans un but
de ce truc qu'on appelle vie.
Très cher Lucien,
Excuse-moi si je t'écris cette lettre. Le fait est que je ne te connais pas ; je te vois, souvent, nommé dans les beaux commentaires de Marco Valdo M.I. placé devant les chansons et les traductions qu'il insère dans ce site. Ce serait peut-être un peu car Ivan della Mea avait un frère qui s'appelait Lucien, et qui l'a précédé d'une année dans la mort; et aussi, un peu car ma mère s'appelle Lucienne. C'est un nom, en somme, qui m'est familier; parfois, il suffit du son d'un nom pour décider de dire quelque chose, même à un inconnu. Ou peut-être, nous connaissons-nous ? Ou peut-être même aussi tu es resté éveillé des nuits entières à boire ce cocktail d'amertume et de joie qu'on appelle la vie ? Qui le sait, qui pourra jamais le savoir ?
La chanson qui se trouve ci-dessous, Lucien, est aussi une Lettre. Elle fut écrite il y a désormais des années par Francesco Guccini, adressée à un de ses amis mort depuis peu. Son ami s'appelait Franco Fortunato Gilberto Augusto Bonvicini, et en raison de son nom kilométrique, il trouva bien de se faire appeler simplement BONVI. De notre côté, dans cette région d'Émilie et de Toscane, qui un temps furent l'Italie Rouge, c'est une habitude commune d'abrévier les noms. On le fait dès l'enfance, à l'école élémentaire; moi même, qui pourtant n'ait pas un nom si long, je fus souvent appelé « Ventu ». Un gars que je connaissais, qui se nommait Griffanti, on l'appelle encore Griffa à soixante ans passés. Et Bonvi, qui ne savait même pas où il était né (à Parme? à Modène ? )devint un des plus grands dessinateurs de BD de ce pays. L'inventeur des Sturmtruppen, pour tout dire; et les Sturmtruppen ont été la plus grande BD antimilitariste italienne, et peut-être aps seulement italienne. Inventées et dessinées par un gars qui, comme il arrive souvent aux plus radicaux des antimilitaristes, était un passionné et un expert en armes et uniformes militaires allemands de la Deuxième guerre mondiale. Justement comme Tonton Brassens qui avait chez lui une collection d'armes anciennes et de pistolets à faire envie à un arsenal.
Je ne sais depuis quand Bonvi et Guccini (qui bien entendu, par l'habitude évoquée plus haut se fait appeler « le Guccio ») étaient amis. Je ne sais ce qu'ils avaient exactement en commun. Une chose est sûre, cependant : ils n'avaient jamais eu de permis de conduire. Et c'est ainsi que Bonvi s'est fait tuer le soir du 10 décembre 1995 : écrasé par une automobile et plein centre de Bologne. Parlerons-nous d'une saloperie du destin, cher Lucien ? Bonvi se rendait à pieds, à une émission de télévision, Roxy Bar, menée par un autre ami, Red Ronnie. Au cours de l'émission, il entendait vendre aux enchères certaines de ses planches et les planches de Bonvi valent beaucoup, beaucoup de sous. Le produit de la vente, penses-tu, devait aller à un autre ami, Roberto Raviola dit Magnus; lui aussi, un des plus grands dessinateurs de BD italiens. Entubé et malade du cancer. Magnus est mort deux mois plus tard, le 5 février 1996.
Je ne sais ce qui devait être passé par la tête de Guccini, et je ne veux pas le chercher. Je ne suis pas enclin à m'insérer dans les douleurs des autres. Je sais seulement, comme des milliers et des milliers d'autres personnes qu'à peine revenu des funérailles de son ami Bonvi, Guccini écrivit d'un trait cette chanson. Sa dernière chanson. Pas parce qu'il n'en a plus écrites d'autres, mais car je considère que c'est son ultime chef d'œuvre, celle dans la quelle il a jeté toute sa vie. Cela arrive avec la mort d'une personne vraiment chère. Il arrive qu'on veuille mettre sur papier, peut-être en l'accompagnant de quelques notes de musique quand on en a la capacité, toute sa vie. C'est pour cela que des poètes et non des moindres (sans et avec musique) ont écrit des testaments, de Villon à Brassens et De André. Guccini, pourtant, a fait différemment. Il l'a fait à sa manière. Il n'a écrit aucun « testament », qui probablement et heureusement n'est pas dans son tempérament. Il a écrit une Lettre à son ami qui depuis quelques heures gisait dans la terre froide et nue. Laquelle, contrairement au fameux « dernier augure » qui se dit en latin sit tibi terra levis - que la terre te sois légère, est toujours trop pesante.
Une Lettre qui est une fresque. Du jour où elle a été écrite. Il ne manque rien, avec cette merveilleuse capacité de Guccini de croquer ce qui l'entourait. C'est une scène de vie quotidienne de celui qui, du reste, a écrit Stanze di vita quotidiana; Il y a les « femmes » de Guccini dans une période où ça ne devait aps aller trop bien, sa femme dont il s'est ensuite séparé et sa fille à qui, quand elle était petite il avait dédié l'affectueux « Culodritto » (voir le wallon : mi p'ti [vî] cou)et à present femme avec ses humeurs, se trouve transformée en « Culotondo » (Gros Cul, peut être aussi, Beau Cul – c'est selon, grosseur et affinité). Il y a toute une préparation à la Question, celle qui vient préannoncée par son vent d'Ouest. La Lettre de Guccini à Bonvi tourne autour de cette Question.
Qui serait : Qui nous rendra notre temps ?
C'est une question commune à tous, formulée par l'auteur, imagine un peu, de la Canzone delle domande consuete. D'autant plus face à la mort. D'autant plus face à la vieillesse. D'autant plus face à la mort conjuguée au sentiment de vieillir. Naturellement, c'est une question sans aucune réponse; c'est une de ces questions qui servent seulement à énoncer ce qu'on n'a plus, ce qu'on sent ne plus avoir. La pénultième strophe de cette chanson/lettre en est hantée. En définitive, cher Lucien, cette strophe contient tous les ingrédients de la Jeunesse qui s'en est allée. Emportant amis, livres, chansons, mythes, tout. En outre, il semble n'y avoir seulement que l'écoulement lent, le flux vers l'embouchure de la vie; cette embouchure à peine passée par Bonvi avant de se perdre dans l'Océan.
Oui, Lucien, j'ai bien fait de t'adresser ma lettre. J'ai bien fait précisément car je ne te connais pas. Justement car tu n'es qu'un nom. Car je dois être une espèce de Martien, ou quelque chose du genre. Je suis un homme qui ne s'est jamais posé cette Question. Je suis quelqu'un qui ne désire pas que le temps lui soit rendu (et par qui, du reste ?). Je n'ai pas besoin de me faire rendre mes saisons; les saisons passées vivent quoi qu'il arrive, et elles donnent encore leurs fruits souvent bizarres. Je n'ai jamais été disposé à me faire reprocher rage, gestes, femmes et chansons; celui qui a essayé voyage à présent sur le dirigeable de l'oubli. Je déteste le reproche. Je déteste reprocher et être réprimandé. Je ne reproche rien à personne, car ce serait comme mettre en question et en doute des choses dont je ne peux connaître l'essence, même chez la personne la plus proche de moi. Je ne reveux pas mes amis perdus, car s'ils se sont perdus, il y a un motif. Je ne reveux pas les livres que j'ai dévorés, car je les dévore encore. La « joie plane » d'un appétit colossal et d'une soif de camion-citerne, je l'ai encore, dès lors, il n'y a pas besoin que quelqu'un me la rende. Quant à la foi aveugle en de pauvres mythes, ben, cher Lucien, celle-là ne s'en ira jamais. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient si pauvres mes mythes; toutefois, à dire vrai, je ne suis pas tout à fait certain que ce soient des mythes. Je préfère les appeler d'un autre nom. Je préfère suivre Ivan della Mea, en ceci. Je préfère ne pas me laisser dominer par la mort, même et surtout face à la mort. Ainsi, je n'ai à me faire rendre mon temps par personne; mon temps je le prends tout seul. Même celui de t'écrire, Lucien, cette lettre au milieu de la nuit.
Justement par cela, j'arrive à comprendre la beauté et la grandeur d'une chanson comme celle-là. Aussi parce que, heureusement, Guccini est un peu un fils de pute. Le temps lui a été superbement rendu : avec un nouvel amour, avec un succès qui ne connaît pas de pause, avec une vieillesse qui semble respecter son ancien souhait de « vieillir bien, et même dirai-je, fort bien » (expression d'une chanson qui s'intitule Les Amis) et, dans le même temps, contredire la Question de la Lettre. Pour le reste, le fardeau d'une vie sera sûrement pesant, mais il peut être aussi plus léger qu'une plume. À condition, chaque jour qui passe, de se sentir vivant chaque fois qu'au réveil, on voit le soleil. Je jour où tu ne le verras plus, tu seras mort; mais à ce moment, tu pourras t'en foutre complètement. Qui sait, Lucien, à nous aussi peut-être on écrira une Lettre. Je ne sais pas toi; mais moi, je ne voudrais pas être dans la peau de celui qui ressentirait – éventuellement, très éventuellement – le besoin de me l'écrire !
Ton Riccardo Venturi
P.S. : J'oubliais, Lucien. As-tu vu l'image de cette page ? Oui, car Bonvi et Guccini ont encore travaillé ensemble. En écrivant une BD de « science-fiction » délirante, désormais introuvable, intitulée Storie dello spazio profondo. Bonvi les dessins; Guccini le texte. À ma façon, ceci aussi est une Histoire de l'Espace Profond, tellement profond à s'y perdre comme dans un verre de bon-vin, bon vin Bonvi.
Remarque de Marco Valdo M.I. à propos de la Lettera de Riccardo Venturi à Lucien Lane.
Dans la littérature depuis les temps qu'elle s'écrit, il y a eu de très étranges dialogues et ceux-ci s'inscrivent tout à fait confortablement dans cet étrange ensemble. Reprenons pour qu'on s'y retrouve un peu. Guccini dialogue avec Bonvi (laissons de côté Magnus...); Venturi dialogue quand même avec Guccini et Bonvi; avec Ivan della Mea; puis, il s'adresse à Lucien Lane, lequel a l'habitude de dialoguer avec Marco Valdo M.I. (avec lequel d'ailleurs le dénommé Venturi entretient des relations épistolaires électroniques) et une série d'autres ânes de tous les lieux et de tous les temps (ou presque – car personne ne sait exactement ni d'où vient, ni de quand vient l'âne Lucien... En vérité, je vous le dis : il vient de la nuit des temps; peut-être même a-t-il – comme il se doit pour l'âne – précédé l'homme).
Voilà qui est bien déroutant !
Mais il y a plus fort encore dans cette étrange missive et c'est ce que suggère ce bout de phrase : « Qui sait, Lucien, à nous aussi peut-être on écrira une Lettre. Je ne sais pas toi; mais moi, je ne voudrais pas être dans la peau de celui qui ressentirait – éventuellement, très éventuellement – le besoin de me l'écrire ! ». Qu'en pense José Saramago ? Rien, sans doute, tant qu'il n'aura pas lu ce texte... Mais à supposer qu'il le fasse, il serait bien étonné et il poserait cette question : « Dans une enveloppe de quelle couleur ? Violette ? »... En français, le roman s'appelle « Les Intermittences de la mort » et la mort, précisément elle, envoie – huit jours à l'avance – l'annonce de la fin prochaine à celle ou celui dont le tour est venu : une lettre dans une enveloppe violette.
Et puis, un jour, elle est toute confuse, elle se sent mal dans sa peau de mort... et elle hésite, puis se retient de remettre la Lettre violette à cet homme...
Est-ce de celle-là qu'il s'agit de Lettre ? Alors, dit Lucien l'âne, moi, je ne la crains pas. Aux ânes, à part Venturi, personne n'envoie de lettre.
Et moi, dit Marco Valdo M.I., je ne la crains pas non plus cette Lettre violette; toutes les morts qui sont venues à moi, les ont ravalées leurs lettres; elles sont restées un certain temps près de moi et puis, elles s'en sont retournées à leurs activités. C'est pas çà, mais même Dieu vient parfois me tenir compagnie, c'est tout dire. Sauf ceci, que Dieu est une femme. Comme quoi, on peut se perdre en Dieu et pour ce qui est de se perdre dans un verre de vin... Pourquoi pas s'il est océanique...
Ainsi Parlait Marco Valdo M.I.
Excuse-moi si je t'écris cette lettre. Le fait est que je ne te connais pas ; je te vois, souvent, nommé dans les beaux commentaires de Marco Valdo M.I. placé devant les chansons et les traductions qu'il insère dans ce site. Ce serait peut-être un peu car Ivan della Mea avait un frère qui s'appelait Lucien, et qui l'a précédé d'une année dans la mort; et aussi, un peu car ma mère s'appelle Lucienne. C'est un nom, en somme, qui m'est familier; parfois, il suffit du son d'un nom pour décider de dire quelque chose, même à un inconnu. Ou peut-être, nous connaissons-nous ? Ou peut-être même aussi tu es resté éveillé des nuits entières à boire ce cocktail d'amertume et de joie qu'on appelle la vie ? Qui le sait, qui pourra jamais le savoir ?
La chanson qui se trouve ci-dessous, Lucien, est aussi une Lettre. Elle fut écrite il y a désormais des années par Francesco Guccini, adressée à un de ses amis mort depuis peu. Son ami s'appelait Franco Fortunato Gilberto Augusto Bonvicini, et en raison de son nom kilométrique, il trouva bien de se faire appeler simplement BONVI. De notre côté, dans cette région d'Émilie et de Toscane, qui un temps furent l'Italie Rouge, c'est une habitude commune d'abrévier les noms. On le fait dès l'enfance, à l'école élémentaire; moi même, qui pourtant n'ait pas un nom si long, je fus souvent appelé « Ventu ». Un gars que je connaissais, qui se nommait Griffanti, on l'appelle encore Griffa à soixante ans passés. Et Bonvi, qui ne savait même pas où il était né (à Parme? à Modène ? )devint un des plus grands dessinateurs de BD de ce pays. L'inventeur des Sturmtruppen, pour tout dire; et les Sturmtruppen ont été la plus grande BD antimilitariste italienne, et peut-être aps seulement italienne. Inventées et dessinées par un gars qui, comme il arrive souvent aux plus radicaux des antimilitaristes, était un passionné et un expert en armes et uniformes militaires allemands de la Deuxième guerre mondiale. Justement comme Tonton Brassens qui avait chez lui une collection d'armes anciennes et de pistolets à faire envie à un arsenal.
Je ne sais depuis quand Bonvi et Guccini (qui bien entendu, par l'habitude évoquée plus haut se fait appeler « le Guccio ») étaient amis. Je ne sais ce qu'ils avaient exactement en commun. Une chose est sûre, cependant : ils n'avaient jamais eu de permis de conduire. Et c'est ainsi que Bonvi s'est fait tuer le soir du 10 décembre 1995 : écrasé par une automobile et plein centre de Bologne. Parlerons-nous d'une saloperie du destin, cher Lucien ? Bonvi se rendait à pieds, à une émission de télévision, Roxy Bar, menée par un autre ami, Red Ronnie. Au cours de l'émission, il entendait vendre aux enchères certaines de ses planches et les planches de Bonvi valent beaucoup, beaucoup de sous. Le produit de la vente, penses-tu, devait aller à un autre ami, Roberto Raviola dit Magnus; lui aussi, un des plus grands dessinateurs de BD italiens. Entubé et malade du cancer. Magnus est mort deux mois plus tard, le 5 février 1996.
Je ne sais ce qui devait être passé par la tête de Guccini, et je ne veux pas le chercher. Je ne suis pas enclin à m'insérer dans les douleurs des autres. Je sais seulement, comme des milliers et des milliers d'autres personnes qu'à peine revenu des funérailles de son ami Bonvi, Guccini écrivit d'un trait cette chanson. Sa dernière chanson. Pas parce qu'il n'en a plus écrites d'autres, mais car je considère que c'est son ultime chef d'œuvre, celle dans la quelle il a jeté toute sa vie. Cela arrive avec la mort d'une personne vraiment chère. Il arrive qu'on veuille mettre sur papier, peut-être en l'accompagnant de quelques notes de musique quand on en a la capacité, toute sa vie. C'est pour cela que des poètes et non des moindres (sans et avec musique) ont écrit des testaments, de Villon à Brassens et De André. Guccini, pourtant, a fait différemment. Il l'a fait à sa manière. Il n'a écrit aucun « testament », qui probablement et heureusement n'est pas dans son tempérament. Il a écrit une Lettre à son ami qui depuis quelques heures gisait dans la terre froide et nue. Laquelle, contrairement au fameux « dernier augure » qui se dit en latin sit tibi terra levis - que la terre te sois légère, est toujours trop pesante.
Une Lettre qui est une fresque. Du jour où elle a été écrite. Il ne manque rien, avec cette merveilleuse capacité de Guccini de croquer ce qui l'entourait. C'est une scène de vie quotidienne de celui qui, du reste, a écrit Stanze di vita quotidiana; Il y a les « femmes » de Guccini dans une période où ça ne devait aps aller trop bien, sa femme dont il s'est ensuite séparé et sa fille à qui, quand elle était petite il avait dédié l'affectueux « Culodritto » (voir le wallon : mi p'ti [vî] cou)et à present femme avec ses humeurs, se trouve transformée en « Culotondo » (Gros Cul, peut être aussi, Beau Cul – c'est selon, grosseur et affinité). Il y a toute une préparation à la Question, celle qui vient préannoncée par son vent d'Ouest. La Lettre de Guccini à Bonvi tourne autour de cette Question.
Qui serait : Qui nous rendra notre temps ?
C'est une question commune à tous, formulée par l'auteur, imagine un peu, de la Canzone delle domande consuete. D'autant plus face à la mort. D'autant plus face à la vieillesse. D'autant plus face à la mort conjuguée au sentiment de vieillir. Naturellement, c'est une question sans aucune réponse; c'est une de ces questions qui servent seulement à énoncer ce qu'on n'a plus, ce qu'on sent ne plus avoir. La pénultième strophe de cette chanson/lettre en est hantée. En définitive, cher Lucien, cette strophe contient tous les ingrédients de la Jeunesse qui s'en est allée. Emportant amis, livres, chansons, mythes, tout. En outre, il semble n'y avoir seulement que l'écoulement lent, le flux vers l'embouchure de la vie; cette embouchure à peine passée par Bonvi avant de se perdre dans l'Océan.
Oui, Lucien, j'ai bien fait de t'adresser ma lettre. J'ai bien fait précisément car je ne te connais pas. Justement car tu n'es qu'un nom. Car je dois être une espèce de Martien, ou quelque chose du genre. Je suis un homme qui ne s'est jamais posé cette Question. Je suis quelqu'un qui ne désire pas que le temps lui soit rendu (et par qui, du reste ?). Je n'ai pas besoin de me faire rendre mes saisons; les saisons passées vivent quoi qu'il arrive, et elles donnent encore leurs fruits souvent bizarres. Je n'ai jamais été disposé à me faire reprocher rage, gestes, femmes et chansons; celui qui a essayé voyage à présent sur le dirigeable de l'oubli. Je déteste le reproche. Je déteste reprocher et être réprimandé. Je ne reproche rien à personne, car ce serait comme mettre en question et en doute des choses dont je ne peux connaître l'essence, même chez la personne la plus proche de moi. Je ne reveux pas mes amis perdus, car s'ils se sont perdus, il y a un motif. Je ne reveux pas les livres que j'ai dévorés, car je les dévore encore. La « joie plane » d'un appétit colossal et d'une soif de camion-citerne, je l'ai encore, dès lors, il n'y a pas besoin que quelqu'un me la rende. Quant à la foi aveugle en de pauvres mythes, ben, cher Lucien, celle-là ne s'en ira jamais. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient si pauvres mes mythes; toutefois, à dire vrai, je ne suis pas tout à fait certain que ce soient des mythes. Je préfère les appeler d'un autre nom. Je préfère suivre Ivan della Mea, en ceci. Je préfère ne pas me laisser dominer par la mort, même et surtout face à la mort. Ainsi, je n'ai à me faire rendre mon temps par personne; mon temps je le prends tout seul. Même celui de t'écrire, Lucien, cette lettre au milieu de la nuit.
Justement par cela, j'arrive à comprendre la beauté et la grandeur d'une chanson comme celle-là. Aussi parce que, heureusement, Guccini est un peu un fils de pute. Le temps lui a été superbement rendu : avec un nouvel amour, avec un succès qui ne connaît pas de pause, avec une vieillesse qui semble respecter son ancien souhait de « vieillir bien, et même dirai-je, fort bien » (expression d'une chanson qui s'intitule Les Amis) et, dans le même temps, contredire la Question de la Lettre. Pour le reste, le fardeau d'une vie sera sûrement pesant, mais il peut être aussi plus léger qu'une plume. À condition, chaque jour qui passe, de se sentir vivant chaque fois qu'au réveil, on voit le soleil. Je jour où tu ne le verras plus, tu seras mort; mais à ce moment, tu pourras t'en foutre complètement. Qui sait, Lucien, à nous aussi peut-être on écrira une Lettre. Je ne sais pas toi; mais moi, je ne voudrais pas être dans la peau de celui qui ressentirait – éventuellement, très éventuellement – le besoin de me l'écrire !
Ton Riccardo Venturi
P.S. : J'oubliais, Lucien. As-tu vu l'image de cette page ? Oui, car Bonvi et Guccini ont encore travaillé ensemble. En écrivant une BD de « science-fiction » délirante, désormais introuvable, intitulée Storie dello spazio profondo. Bonvi les dessins; Guccini le texte. À ma façon, ceci aussi est une Histoire de l'Espace Profond, tellement profond à s'y perdre comme dans un verre de bon-vin, bon vin Bonvi.
Remarque de Marco Valdo M.I. à propos de la Lettera de Riccardo Venturi à Lucien Lane.
Dans la littérature depuis les temps qu'elle s'écrit, il y a eu de très étranges dialogues et ceux-ci s'inscrivent tout à fait confortablement dans cet étrange ensemble. Reprenons pour qu'on s'y retrouve un peu. Guccini dialogue avec Bonvi (laissons de côté Magnus...); Venturi dialogue quand même avec Guccini et Bonvi; avec Ivan della Mea; puis, il s'adresse à Lucien Lane, lequel a l'habitude de dialoguer avec Marco Valdo M.I. (avec lequel d'ailleurs le dénommé Venturi entretient des relations épistolaires électroniques) et une série d'autres ânes de tous les lieux et de tous les temps (ou presque – car personne ne sait exactement ni d'où vient, ni de quand vient l'âne Lucien... En vérité, je vous le dis : il vient de la nuit des temps; peut-être même a-t-il – comme il se doit pour l'âne – précédé l'homme).
Voilà qui est bien déroutant !
Mais il y a plus fort encore dans cette étrange missive et c'est ce que suggère ce bout de phrase : « Qui sait, Lucien, à nous aussi peut-être on écrira une Lettre. Je ne sais pas toi; mais moi, je ne voudrais pas être dans la peau de celui qui ressentirait – éventuellement, très éventuellement – le besoin de me l'écrire ! ». Qu'en pense José Saramago ? Rien, sans doute, tant qu'il n'aura pas lu ce texte... Mais à supposer qu'il le fasse, il serait bien étonné et il poserait cette question : « Dans une enveloppe de quelle couleur ? Violette ? »... En français, le roman s'appelle « Les Intermittences de la mort » et la mort, précisément elle, envoie – huit jours à l'avance – l'annonce de la fin prochaine à celle ou celui dont le tour est venu : une lettre dans une enveloppe violette.
Et puis, un jour, elle est toute confuse, elle se sent mal dans sa peau de mort... et elle hésite, puis se retient de remettre la Lettre violette à cet homme...
Est-ce de celle-là qu'il s'agit de Lettre ? Alors, dit Lucien l'âne, moi, je ne la crains pas. Aux ânes, à part Venturi, personne n'envoie de lettre.
Et moi, dit Marco Valdo M.I., je ne la crains pas non plus cette Lettre violette; toutes les morts qui sont venues à moi, les ont ravalées leurs lettres; elles sont restées un certain temps près de moi et puis, elles s'en sont retournées à leurs activités. C'est pas çà, mais même Dieu vient parfois me tenir compagnie, c'est tout dire. Sauf ceci, que Dieu est une femme. Comme quoi, on peut se perdre en Dieu et pour ce qui est de se perdre dans un verre de vin... Pourquoi pas s'il est océanique...
Ainsi Parlait Marco Valdo M.I.
Marco Valdo M.I. - 3/7/2009 - 21:34
Come in altre canzoni di Guccini (L'isola non trovata, Incontro), si ritrovano frammenti di un poesia di Gozzano, una delle più malinconiche: "La via del rifugio".
Resupino sull’erba
[...]
non penso a che mi serba
la Vita.
[...]
Verrà da sé la cosa
vera chiamata Morte:
che giova ansimar forte
per l’erta faticosa?
[...]
La Vita? Un gioco affatto
degno di vituperio,
se si mantenga intatto
un qualche desiderio.
Un desiderio? sto
supino nel trifoglio
e vedo un quatrifoglio
che non raccoglierò.
Resupino sull’erba
[...]
non penso a che mi serba
la Vita.
[...]
Verrà da sé la cosa
vera chiamata Morte:
che giova ansimar forte
per l’erta faticosa?
[...]
La Vita? Un gioco affatto
degno di vituperio,
se si mantenga intatto
un qualche desiderio.
Un desiderio? sto
supino nel trifoglio
e vedo un quatrifoglio
che non raccoglierò.
Paolo - 7/9/2012 - 22:27
Favolosa esplicazione di una già chiara ma altrettanto musicale poesia della Lettera.
Commovente l'ispirazione al lutto di uno di quegli strani artisti bolognesi...senza patente, senza laurea perché non discussa. D'accordo nel definirla un capolavoro e probabilmente ultima e vera opera del Gigante. Anzi speriamo di proprio di no. Grazie infinite!
Commovente l'ispirazione al lutto di uno di quegli strani artisti bolognesi...senza patente, senza laurea perché non discussa. D'accordo nel definirla un capolavoro e probabilmente ultima e vera opera del Gigante. Anzi speriamo di proprio di no. Grazie infinite!
Marco Maioli collab. Archivio nazionale Cantastorie Motteggiana MN - 1/11/2015 - 17:52
Carissimo Marco Maioli,
Chissà se quella che hai espresso sarà una speranza più o meno vana. A giudicare dalla realtà delle cose, parrebbe di sì perché Francesco Guccini sembra essere approdato alla sua Ultima Thule, musicalmente parlando. Si è scoperto però poi che non era affatto ultima, quella Thule; c'è sempre qualcosa oltre, più in là. Così, chissà. A condizione che eventuali altre canzoni che gli saltassero fuori dall'Imponderabile non fossero, poi, definite il "canto del cigno"; tutto, ma Guccini in veste di cigno no. Casomai canto del cignale; e che Iddio lo benedica comunque, sebbene non esista. Saluti cari!
Chissà se quella che hai espresso sarà una speranza più o meno vana. A giudicare dalla realtà delle cose, parrebbe di sì perché Francesco Guccini sembra essere approdato alla sua Ultima Thule, musicalmente parlando. Si è scoperto però poi che non era affatto ultima, quella Thule; c'è sempre qualcosa oltre, più in là. Così, chissà. A condizione che eventuali altre canzoni che gli saltassero fuori dall'Imponderabile non fossero, poi, definite il "canto del cigno"; tutto, ma Guccini in veste di cigno no. Casomai canto del cignale; e che Iddio lo benedica comunque, sebbene non esista. Saluti cari!
Riccardo Venturi - 2/11/2015 - 00:46
×
![]()
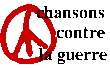





[1996]
Parole e musica di Francesco Guccini
Paroles et musique: Francesco Guccini
Album: D'amore di morte e d'altre sciocchezze
Scusa se ti scrivo questa lettera. Il fatto è che io non ti conosco; ti vedo, spesso, nominato nei bei commenti che Marco Valdo M.I. antepone alle canzoni e alle traduzioni che inserice in questo sito. Sarà un po' perché Ivan della Mea aveva un fratello che pure si chiamava Luciano, e che lo ha preceduto di qualche anno nella morte; e anche un po' perché mia madre si chiama Luciana. E' un nome, insomma, che mi è consueto; a volte basta il suono di un nome per decidere di dire qualcosa, anche ad uno sconosciuto. O forse ci conosciamo? O forse anche tu sei stato sveglio per notti intere a bere quel cocktail d'amarezza e d'allegria che si chiama vita? Chi lo sa, chi lo potrebbe mai sapere.
Anche la canzone che sta qua sotto, Luciano, è una Lettera. È stata scritta oramai molti anni fa da Francesco Guccini, indirizzata ad un suo amico morto da poco. Il suo amico si chiamava Franco Fortunato Gilberto Augusto Bonvicini, e per quel suo nome chilometrico pensò bene di farsi semplicemente chiamare Bonvi. Dalle nostre parti, in quelle contrade d'Emilia e di Toscana che un tempo furono l'Italia Rossa, è un vezzo consueto quello di abbreviarci il cognome. Lo si fa fin da bambini, alla scuola elementare; io stesso, che pure non ho un cognome lunghissimo, sono stato chiamato spesso “Ventu”. Un tipo che conosco, che di cognome fa Griffanti, ancora lo chiamano “Griffa” a sessant'anni sonati. E il Bonvi, che non sapeva neppure dov'era nato (a Parma? a Modena?) diventò uno dei più grandi disegnatori e fumettisti di questo paese. L'inventore delle Sturmtruppen, per intenderci; e le Sturmtruppen sono state il più grande fumetto antimilitarista italiano, e forse non solo italiano. Inventate e disegnate da uno che, come succede spesso ai più radicali antimilitaristi, era un appassionato e un esperto di armi e di divise militari tedesche della II guerra mondiale. Proprio come tonton Brassens aveva in casa una collezione di armi antiche e di pistole da fare invidia a un arsenale.
Non so da quanto Bonvi e Guccini (che, beninteso, per il vezzo di cui sopra si fa chiamare “il Guccio”) fossero amici. Non so che cosa avessero esattamente in comune. Una cosa di sicuro, però: non avevano mai preso la patente di guida. Ed è così che il Bonvi s'è fatto ammazzare la sera del 10 dicembre 1995: investito da un'automobile in pieno centro di Bologna. Vogliamo parlare di carogneria del destino, caro Luciano? Bonvi si stava recando, a piedi, a una trasmissione televisiva, Roxy Bar, condotta da un altro amico, Red Ronnie. Alla trasmissione intendeva vendere all'asta alcune sue tavole, e delle tavole di Bonvi valgono molti, molti soldi. Il ricavato della vendita, pensa tu, doveva andare ad un altro amico, Roberto Raviola detto Magnus; a sua volta, un altro dei più grandi fumettisti italiani. Ridotto povero in canna e malato di cancro. Magnus è morto due mesi dopo, il 5 febbraio 1996.
Non so che cosa dev'essere passato per la testa a Guccini, e non lo voglio indagare. Non sono, caro Luciano, prono ad inserirmi nei dolori degli altri. So soltanto, come migliaia e migliaia di altre persone, che, appena tornato dai funerali del suo amico Bonvi, Guccini scrisse di getto questa canzone. L'ultima sua canzone. Non perché non ne abbia scritte altre; ma perché la considero l'ultimo suo capolavoro, quella dove ha buttato dentro la sua vita. Succede al cospetto della morte di una persona davvero cara. Succede di voler mettere su carta, magari accompagnandolo con delle note musicali quando se ne ha la capacità, tutta la propria vita. È per questo che non pochi poeti (senza e con la musica) hanno scritto dei testamenti, da Villon a Brassens e De André. Guccini ha fatto, però, diversamente. Ha fatto a modo suo. Non ha scritto alcun “testamento”, ché -probabilmente e fortunatamente- non è nella sua indole. Ha scritto una Lettera al suo amico che da poche ore giaceva nella nuda e fredda terra. La quale, contrariamente al famoso “ultimo augurio” che suona sit tibi terra levis in latino, e “che la terra ti sia lieve” in italiano, è sempre pesantissima.
Una Lettera che è un affresco. Della giornata in cui è stata scritta. Non manca niente, con quella meravigliosa capacità che Guccini aveva di pennellare quel che gli stava attorno. E' una scena di vita quotidiana di colui che, del resto, ha scritto Stanze di vita quotidiana; ci sono anche le “donne di casa” di Guccini in un periodo in cui non ci doveva andare molto d'accordo, la moglie da cui poi si è separato e la figlia cui, quand'era piccina, aveva dedicato l'affettuosa Culodritto e che ora, ragazza con le sue paturnie, si trova trasformata in Culotondo. È tutta una preparazione alla Domanda, quella che viene preannunciata con il suo libeccio. La Lettera di Guccini a Bonvi ruota attorno a questa Domanda.
La quale sarebbe: Chi ce lo rende il tempo?
È una domanda consueta di tutti, formulata dall'autore, guarda un po' tu, della Canzone delle domande consuete. Tanto più di fronte alla morte. Tanto più di fronte all'invecchiare. Tanto più di fronte alla morte coniugata con il sentimento d'invecchiare. Naturalmente è una domanda senza nessuna risposta; è una di quelle domande che servono soltanto per enunciare ciò che non si ha più, o si sente di non avere più. La penultima strofa intera di questa canzone/lettera ne è occupata. In definitiva, caro Luciano, quella strofa contiene tutti gli ingredienti della Giovinezza che è andata via. Portandosi via amici, libri, canzoni, miti, tutto quanto. Oltre sembra esserci soltanto lo scorrimento lento, il fluire verso la foce della vita; quella foce appena passata da Bonvi prima di perdersi nell'Oceano.
Sì, Luciano, ho fatto bene a rivolgerti questa mia lettera. Ho fatto bene proprio perché non ti conosco. Proprio perché sei soltanto un nome. Perché devo essere una specie di marziano, o qualcosa del genere. Sono uno che non si è mai posto quella Domanda. Sono uno che non desidera che il tempo mi venga reso (e da chi, del resto?). Non ho da farmi rendere stagioni: le stagioni passate vivono comunque, e danno ancora i loro spesso bizzarri frutti. Non sono mai stato disposto a farmi rimproverare rabbia, gesti, donne e canzoni; chi ci ha provato viaggia oramai sul dirigibile dell'oblio. Detesto il rimprovero. Detesto rimproverare e essere rimproverato. Non rimprovero niente a nessuno, perché sarebbe come mettere in questione e in dubbio delle cose la cui essenza non posso conoscere, nemmeno nella persona a me più vicina. Non rivoglio gli amici perduti, perché se si sono perduti ci sarà un motivo. Non rivoglio i libri divorati perché me li divoro ancora. La “gioia piana” di un appetito colossale e di una sete da autocisterna ce l'ho ancora, quindi non c'è bisogno che nessuno me la renda. Quanto alla fede cieca in dei poveri miti, beh, caro Luciano, quella non andrà mai via. E non sono neppure certo che siano così poveri, i miei miti; anzi, a dire il vero non sono affatto certo persino che siano miti. Preferisco chiamarli con un altro nome. Preferisco seguire Ivan della Mea, in questo. Preferisco non lasciarmi sopraffare dalla morte, anche e soprattutto di fronte alla morte. Così non avrò da farmi rendere il tempo da nessuno: il tempo me lo prendo da solo. Anche quello di scriverti, Luciano, questa lettera a cavallo di una mezzanotte.
Proprio per questo, sai, riesco a comprendere bene la bellezza e la grandezza di una canzone come questa. Anche perché, fortunatamente, il Guccini è un po' un figlio di puttana. Il tempo gli è stato reso eccome: con un nuovo amore, con un successo che non conosce pause, con una vecchiaia che sembra rispettare il suo vecchio augurio di “invecchiar bene, anzi direi, benone” (espresso in una canzone che si intitola Gli amici) e, al contempo, contraddire proprio la Domanda della Lettera. Per il resto, il fardello di una vita sarà sicuramente pesante, ma può essere anche più leggero di una piuma. A condizione, ogni giorno che passa, di sentirsi vivo ogni volta che, al risveglio, vedi il sole. Il giorno che non lo vedrai più, sarai morto; ma, a quel punto, te ne potrai oltremodo fregare. Chissà, Luciano, magari anche a noi scriveranno una Lettera. Non so te; ma io non vorrei essere nei panni di chi senta -eventualmente, molto eventualmente- il bisogno di scrivermela!
tuo Riccardo Venturi.
PS. Dimenticavo, Luciano. L'hai vista l'immagine in questa pagina? Sì, perché Bonvi e Guccini hanno anche lavorato assieme. Scrivendo uno squinternato fumetto di "fantascienza", oramai introvabile, intitolato Storie dello spazio profondo. Bonvi i disegni, e Guccini il testo. A modo mio, anche questa è una Storia dallo Spazio Profondo, talmente profondo da perdercisi come in un bicchiere di vino buono.